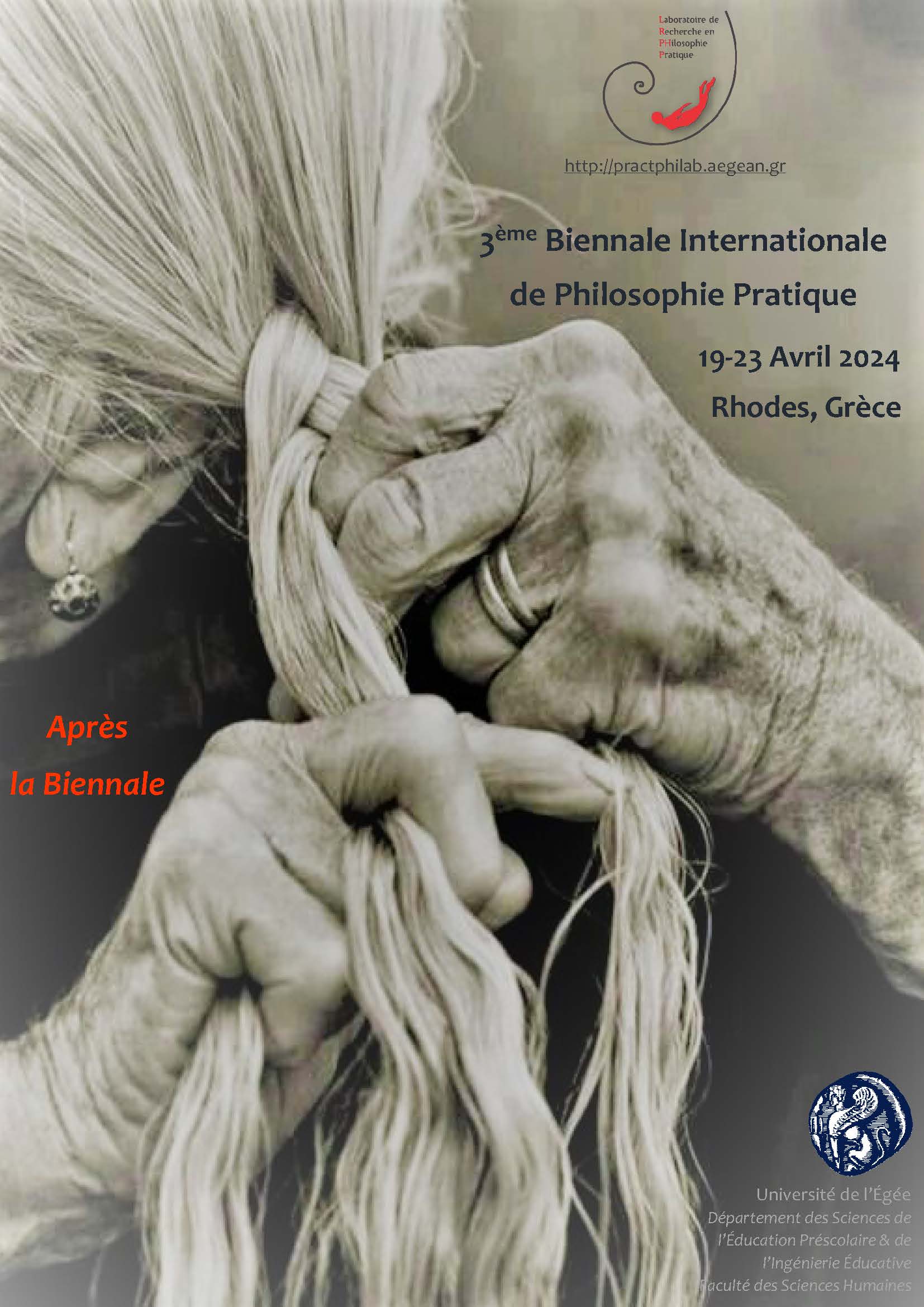Pour lire l'article :
Kennedy, D., ''Second Nature becoming child and dialogical schooling'', Studies in Philosophy and Education, Springer, 2020.
cliquez ici
Résumé
Cet article soutient que les enfants, en tant que membres d'une psychoclasse pérenne, représentent une avant-garde potentielle d'un changement émergent dans la subjectivité occidentale, et que le dialogue adulte-enfant, en particulier dans le contexte de la scolarisation, est un lieu clé pour le changement épistémologique que cela implique. Je m'appuie sur l'invocation prophétique d'Herbert Marcuse d'une "nouvelle sensibilité", caractérisée par une augmentation de la répulsion instinctive à l'égard de la violence, de la domination et de l'exploitation (qu'elles soient personnelles ou structurelles) et, en conséquence, par une plus grande sensibilité à l'égard de toutes les formes de vie. En tant qu'incarnation d'une forme de "post-animisme" philosophique ou d'hylozoïsme, il représente le changement évolutif dont, pourrait-on dire, notre espèce a besoin pour survivre à ce moment de l'histoire. Je suggère que le phénomène évolutif de la néoténie - la longue période de formation de l'enfance humaine et le caractère pédomorphe des humains tout au long du cycle de vie - fait du collectif d'adultes de l'école un site primaire pour la reconstruction des croyances. Après avoir exploré plus largement le dialogue enfant-adulte comme une forme d'interaction dialectique entre ce que John Dewey appelait "l'impulsion" et "l'habitude", je plaide en faveur d'une forme ou d'un archétype d'éducation formulée pour la première fois dans la Grèce antique sous le nom de skholé, un espace qui fonctionne, selon Jan Masschelein et Maarten Simons, comme un "lieu de rencontre", une "forme de rassemblement et d'action" dédiée à la recherche et non à la production de résultats calculés et préétablis - un espace éloigné du monde de la production et caractérisé par une forme de temporalité associée à l'enfance : un espace éloigné du monde de la production et caractérisé par une forme de temporalité associée à l'enfance : l'aion, ou "temps intemporel", par opposition au kronos, ou temps linéaire. Skholé se consacre à l'émergence et à la reconstruction culturelle, qui découlent d'une relation éducative entre adultes et enfants fondée sur la compréhension de ces derniers en tant que porteurs du "roman", et sur la foi dans les "potentialités réorganisatrices" de l'impulsion, ou de l'intérêt, de l'enfance, c'est-à-dire sur la natalité en tant que principe fondamental de l'évolution culturelle. Est-il trop tard pour que l'espèce s'auto-enculture dans une nouvelle relation entre le cortex préfrontal et le système limbique - une nouvelle organisation du désir - et, en tant que telle, une nouvelle relation avec la nature - c'est-à-dire une forme normative émergente de subjectivité culturellement médiatisée qui agit pour "retrouver le continuum entre notre "première nature" et notre "seconde nature", notre monde naturel et notre monde social, notre être biologique et notre rationalité" ?
Quelques Concepts / Questions liées au texte. Ajoutez les vôtres !
- Qu'entend-on par "nature humaine" ?
- L'espèce humaine évolue-t-elle ? Si oui, comment cela se passe-t-il ?
- Les phénomènes de néoténie et de pédomorphisme ont-ils une signification évolutive ?
- Qu'entendons-nous par "natalité" ?
- Les enfants sont-ils membres d'une classe opprimée ? Si tel est le cas, que signifierait l'émancipation ?
- Qu'est-ce que les adultes ont à apprendre des enfants ?
- Qu'entend-on par "école" ?
- Que signifierait pour une école de passer d'une "communauté naturelle" à une "communauté d'interprétation" ? (13)
- Qu'est-ce que cela signifierait de "responsabiliser" les enfants ?
- Existe-t-il un psychoclasse démocratique ?
- Qu'est-ce que Ricœur entend par "un moi élargi" ? (10)
- La nouvelle sensibilité est-elle déjà présente parmi nous ?
- Quel est le moteur de la reconstruction épistémologique ?
- Quel est le rôle du dialogue philosophique communautaire dans la reconstruction de la croyance ?
** David Kennedy ne lira pas son document à haute voix et ne le "parlera" pas, mais il s'attend plutôt à ce que les participants et participantes l'aient lu ou au moins survolé, de sorte qu'ils/elles puissent tous et toutes poser des questions, en choisir une pour commencer et s'engager dans un dialogue commun.